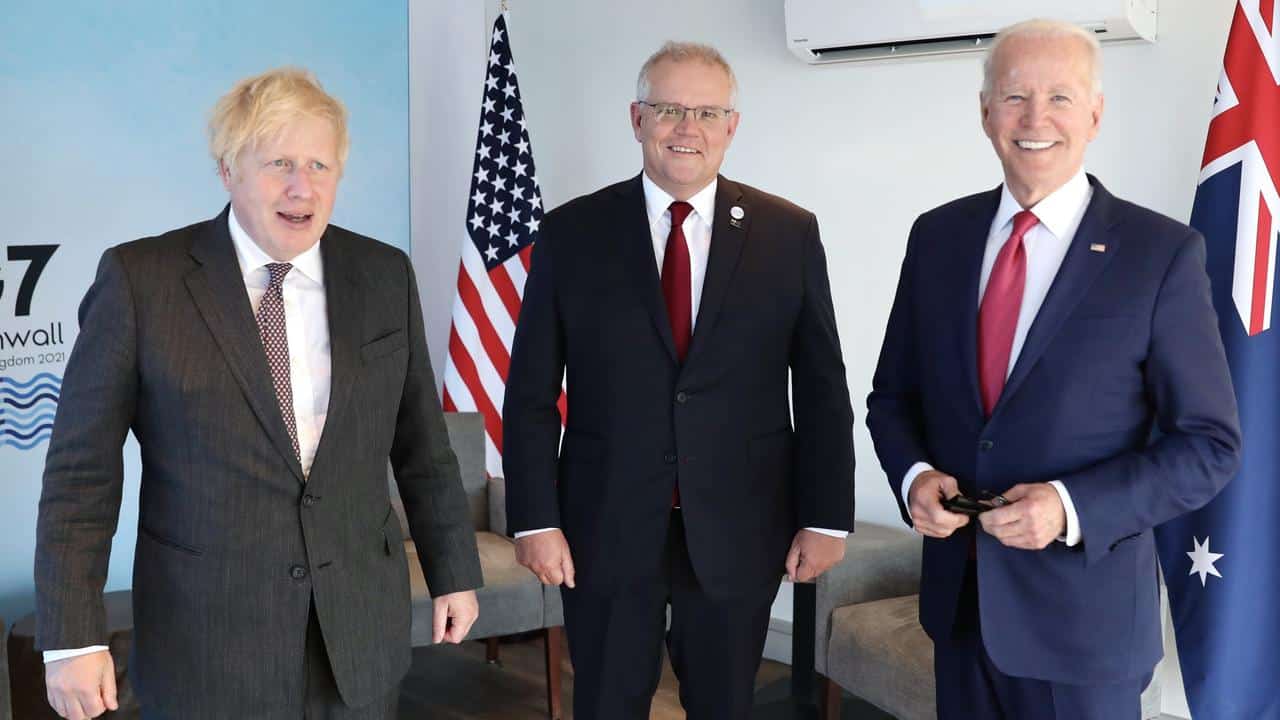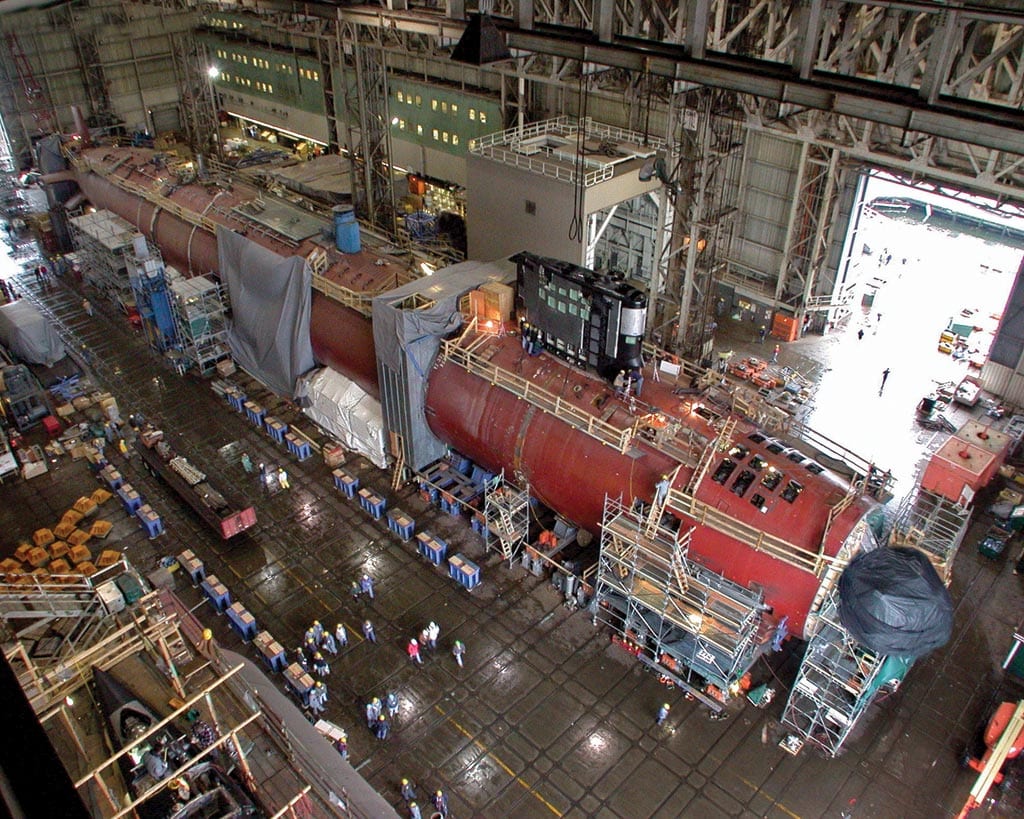C’est un Mark Rutte, le secrétaire général de l’OTAN, tout sourire, qui s’est exprimé devant la presse après la réunion des ministres de la Défense de l’Alliance, le 5 juin, à Bruxelles. En effet, il a obtenu de ces ministres un accord unanime concernant la feuille de route capacitaire de l’Alliance pour les années à venir, et la remontée en puissance des armées européennes qu’elle suppose, afin de faire face à l’évolution du potentiel militaire russe.
Cet accord pave, en effet, la voie pour que le sommet de La Haye, du 24 au 26 juin, devienne le sommet de la refondation et du renouveau, avec le très ambitieux objectif d’atteindre un effort de défense plancher, pour l’ensemble des membres, de 5 % du PIB, dont 3,5 % pour les seules armées, dans les quelques années à venir.
Cependant, au-delà de la confiance du secrétaire général de l’OTAN, il apparaît que l’accord demeure encore loin d’être concrétisé, même s’il semble inéluctable maintenant que les ministres ont validé cette montée en puissance capacitaire, alors que les tensions transparaissent déjà dans le discours, ou l’absence de discours, de certains de ses membres.
Sur quels aspects les ministres de la Défense de l’Alliance Atlantique se sont-ils entendus, ce 5 juin ? À quoi correspond cet objectif d’effort de défense de 5 % du PIB, d’abord réclamé par Donald Trump, puis repris par Mark Rutte ? Quelles sont les conséquences pouvant être anticipées sur la sécurité collective, une fois qu’il sera atteint ? Et comment des pays très exposés politiquement ou budgétairement, comme la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la France, pourront-ils y parvenir ?
Sommaire
Les ministres de la Défense de l’OTAN se sont entendus sur la feuille de route capacitaire de l’alliance dans les années à venir pour contenir la menace Russe
Ces dernières semaines, de nombreuses déclarations, plus ou moins officielles, avaient tracé les contours des décisions qui seront prises à l’occasion du sommet de l’OTAN de La Haye, du 24 au 26 juin, aux Pays-Bas.

On en sait à présent beaucoup plus à ce sujet, à l’issue de la réunion ayant rassemblé, le 5 juin, les ministres de la Défense de l’Alliance atlantique, à Bruxelles. Lors de la conférence de presse donnée à l’issue de cette rencontre, le secrétaire général de l’OTAN, le Néerlandais Mark Rutte, a effectivement annoncé que l’ensemble des ministres avait avalisé le plan de reconstruction capacitaire resserré qui sera appliqué lors des quelques années à venir, et spécialement conçu pour contenir l’évolution de la menace russe.
Au sommet de La Haye, Mark Rutte proposera d’amener l’effort de défense exigé par l’OTAN à 5% PIB, dont 3,5 % pour les armées.
Cet accord ouvre la voie à un second accord, qui devrait être entériné à l’occasion du sommet de La Haye, lequel promet d’être un sommet historique. En effet, à cette occasion, les chefs d’État devraient s’entendre pour s’engager à augmenter leurs dépenses de défense, sur un calendrier resserré, à hauteur de 5 % de leur produit intérieur brut, dont 3,5 % pour la mission défense (“core defense” dans le texte), et 1,5 % pour les investissements de soutien, comme les pensions, les infrastructures et l’évolution de l’industrie de défense.
Selon Mark Rutte, les contours exacts de cet accord, notamment son calendrier et les périmètres de chacune des tranches, font encore l’objet de négociations, certains pays souhaitant notamment intégrer les actions en faveur du climat dans cette enveloppe, ou viser une échéance à 2035, et non 2032.
Pour autant, selon le secrétaire général, la trajectoire capacitaire étant d’ores et déjà fixée et validée, il ne doute pas qu’un accord final soit acquis lors du sommet. Il précise, par ailleurs, que les erreurs faites lors du sommet de 2014, ayant donné toute latitude aux États membres quant au calendrier des hausses budgétaires pour atteindre le seuil des 2 % du PIB à échéance 2025, ne seront pas reproduites, et que chaque pays devra respecter une trajectoire établie avec des échéances annuelles, pour contenir toute dérive.
Les négociations demeurent tendues pour définir les périmètres et le calendrier de ces objectifs qui bénéficient du très puissant soutien américain
Cependant, si beaucoup de ministres, à la sortie de cette réunion, affichaient une mine satisfaite lors de la traditionnelle photo de famille, certains d’entre eux affichaient davantage un visage fermé.

C’était particulièrement le cas de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense américain, qui indiqua, à cette occasion, que certains pays, dont il ne citerait pas les noms, se montraient encore rétifs quant à ces objectifs, tout en précisant que la présence de Donald Trump, lors du futur sommet, devrait garantir qu’un accord soit effectivement entériné à cette occasion.
En d’autres termes, si certains continuent de faire de la résistance, par exemple sur le calendrier ou les périmètres concernés, le président américain n’hésitera pas à leur tordre le bras, diplomatiquement parlant, pour les amener à adopter l’accord.
On ignore cependant si ce qu’a laissé entendre M. Hegseth reflète effectivement des désaccords persistants et potentiellement bloquants entre les membres, ou s’il ne s’agit que de valoriser les talents de coercition et de négociation du président américain, dans un narratif qu’il affectionne particulièrement.
Quelle est la logique derrière cet effort de défense de 5% PIB au sein de l’OTAN
Le flou quant aux ambitions qui sous-tendent la communication présidentielle américaine, dans ce domaine, s’étend également au sujet de l’objectif lui-même d’un effort de défense plancher à 5 % du PIB, dont aucune communication officielle n’est venue, jusqu’à présent, justifier la valeur.
Or, si les explications données aux journalistes accrédités, que ce soit par Mark Rutte, Pete Hegseth ou Donald Trump, sont parfois confuses, et souvent bien peu convaincantes, on peut toutefois trouver une réelle logique derrière ces deux valeurs.
Un seuil fixé par Donald Trump en campagne, mais repris par les instances de l’OTAN
Mais ce seuil de 5 %, d’où vient-il, précisément ? La première fois qu’une telle valeur a été évoquée publiquement, ce fut par Donald Trump, peu de temps avant son retour dans le Bureau ovale. Pour le, alors, candidat élu et futur 47ᵉ président des États-Unis, il était nécessaire que les Européens « paient leur dû » en matière d’investissement de défense aux États-Unis, et ne profitent plus, indûment, des investissements américains pour bénéficier d’une protection militaire à bas prix.

L’origine de cette valeur, dans les mots de Donald Trump, demeure un mystère. Pendant toute la campagne électorale, celui-ci avait promis de forcer les Européens à augmenter leur effort de défense à 3 % du PIB, contre les 2 % visés en 2025 par le sommet de Glasgow. Le calcul avancé était alors très simple : les États-Unis dépensant plus de 3 % dans leurs armées, il était nécessaire que les Européens fassent de même, s’ils entendaient profiter de la protection américaine.
Pour le candidat et favori des sondages, face à un camp démocrate en manque de leadership, il s’agissait alors surtout de faire valoir ses atouts de négociateur, comme c’était le cas lorsqu’il affirmait qu’une fois élu, il lui faudrait 24 heures pour mettre fin au conflit en Ukraine…
Dans le cas de l’effort de défense européen aussi, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Donald Trump. En effet, à peine était-il élu, que les Européens s’entendaient effectivement pour, collectivement, dépenser plus pour leur défense, au-delà de 3 % du PIB. Au temps pour les talents de négociateur : la menace russe avait fini de convaincre les Européens avant que Trump puisse tordre le bras à qui que ce soit — et en particulier à l’Allemagne, dans son viseur pour obtenir des mesures compensatoires destinées à rééquilibrer le déficit commercial américain.
Face à ce revers, Trump changea donc son fusil d’épaule début janvier, à quelques jours de l’investiture présidentielle, en exigeant à présent un effort de défense de 5 % des Européens, pour qu’ils continuent à bénéficier de la protection de Washington au travers de l’article 5 de l’OTAN.
Sans explicitement justifier ce chiffre, on pouvait comprendre, dans ses explications, qu’il entendait à présent que les Européens dépensent autant que les États-Unis en matière de défense, en valeur absolue, ce qui représente effectivement un effort de défense de 4,7 % du PIB pour les membres européens de l’Alliance, Norvège et Royaume-Uni compris, afin d’atteindre les 1 000 Md$ du budget 2026 du Pentagone.
Pour Mark Rutte, ces seuils sont nécessaires pour répondre à l’évolution de la menace russe et chinoise, et pour aligner l’effort de défense des membres de l’OTAN sur les États-Unis
Autre salle, autre ambiance, mais même sujet pour le secrétaire général de l’OTAN. Bien que l’influence trumpienne soit incontestable pour amener ce dernier à défendre un accord visant les 5 % du PIB, Mark Rutte justifie ce montant, et son découpage à 3,5 % pour les armées elles-mêmes, et 1,5 % pour le soutien, d’ici à 2032 (ou 2035), par une tout autre explication.

Selon le discours tenu ces dernières semaines, et répété en amont et en conclusion de la rencontre des ministres de la Défense du 5 juin, celui-ci explique, en effet, que ces seuils sont nécessaires pour atteindre une réponse capacitaire suffisante, au niveau de l’Alliance, dans les délais requis, face à l’évolution de la menace russe.
En d’autres termes, pour être en mesure de dissuader Moscou d’une opération militaire contre l’Alliance, avec ou sans le soutien de Pékin, et en prenant pour hypothèse une possible confrontation sino-américaine dans le Pacifique, il était nécessaire, pour les Européens et les Canadiens, de s’engager sur cet objectif capacitaire, et donc sur cet objectif budgétaire.
De fait, les ministres de la Défense de l’Alliance ayant d’ores et déjà validé le volet capacitaire, le 5 juin, Mark Rutte se montre parfaitement confiant quant à l’obtention d’un accord à ce sujet lors du sommet de La Haye.
Sans que ce soit directement évoqué, on comprend, dans les propos du secrétaire général, qu’il s’agit là d’un effort de rattrapage, qui sera très certainement appelé à diminuer une fois le rattrapage effectif atteint, pour garantir le potentiel dissuasif de l’Alliance. Il précise, à ce titre, que cet objectif concernera tous les membres, y compris les États-Unis, ce qui tend à s’éloigner de l’objectif de Donald Trump d’un effort de défense équilibré entre États-Unis et Européens en valeur absolue, formulé en janvier, pour revenir à un effort équilibré en valeur relative, d’avant l’élection.
Pour autant, Mark Rutte n’a pas détaillé la phase de stabilisation ni les seuils qui seront alors visés, une fois atteinte. Il est probable que le sujet soit très prématuré aujourd’hui, sachant qu’on ignore, alors, quelle sera la position des États-Unis et de son exécutif ? Ou encore, quelle sera la position de Moscou, une fois Poutine, qui aura alors plus de 80 ans, écarté du pouvoir pour une raison ou une autre ?
Les européens doivent être en mesure de contenir, seuls, la menace Russe, alors que les USA se concentreront sur la Chine.
Reste que l’objectif tracé par Mark Rutte en dit plus que ne le déclare le secrétaire général de l’OTAN. En effet, avec un effort de défense à 5 % du PIB, les Européens dépenseront, peu ou prou, 900 Md$ chaque année pour leurs armées, hors inflation/croissance, soit presque autant que les États-Unis, et exactement six fois plus que ne dépense aujourd’hui la Russie.

Or, nous savons que le coefficient compensateur de la parité de pouvoir d’achat de la Russie s’établit autour de 3,5 aujourd’hui, avec un PIB équivalent russe de 7 300 Md$, contre 2 000 Md$ en nominal. En d’autres termes, l’effort de défense actuel russe de 155 Md$ doit être considéré, en Occident, comme un effort équivalent de 542 Md$ 2025, soit 2,6 % du PIB européen.
À cela, il convient d’ajouter un coefficient de correction concernant l’OTAN, qui se compose d’un agrégat d’armées nationales, et non d’une force armée unifiée, ce qui multiplie les dépenses répétées. Surtout, en dehors des pays strictement limitrophes de la Russie et de la Biélorussie, on peut admettre qu’aucun de ces pays n’engagera jamais plus de la moitié de ses effectifs combattants dans la défense collective de l’Alliance.
Bien que cela mérite une étude approfondie dépassant de loin l’objet de cet article, nous admettrons, au doigt mouillé, que ce coefficient de correction équivaut à 40 % d’investissements non comptabilisables dans l’Alliance, ou, par simplification, nous augmenterons le budget russe de défense équivalent d’un facteur 1,67, ce qui amène le budget russe équivalent, aujourd’hui, à 903 Md$, pour les pays européens de l’Alliance. Ce qui, reconnaissons-le, s’avère bien représenter l’équivalent d’un effort de défense Europe de 5 % du PIB.
Cette convergence de valeurs laisse donc supposer, sans être médium, que l’idée directrice poursuivie par l’OTAN et Mark Rutte, et probablement exigée par Donald Trump, est bien de s’assurer que les Européens, sous commandement américain, seront en mesure de contenir, à eux seuls, la Russie en Europe, sans devoir s’appuyer sur les forces conventionnelles américaines.

Si l’intérêt pour les Européens semble évident, celui pour les États-Unis va bien au-delà de libérer l’ensemble, ou presque, des forces conventionnelles américaines pour faire face à la Chine dans le Pacifique. En effet, avec une telle force militaire européenne, à 1 000 km de Moscou, il sera alors impossible à la Russie de prêter main-forte à Pékin, sur le théâtre Pacifique, sans dégarnir au-delà de l’acceptable le flanc ouest du pays.
En d’autres termes, ce faisant, Trump s’assurera de faire payer les Européens pour neutraliser un allié décisif de Pékin dans une possible confrontation dans le Pacifique. On ne saura probablement jamais s’il s’agit d’une heureuse conséquence d’une posture essentiellement destinée à des objectifs de politique intérieure, avec des arrière-pensées économiques de Trump, ou si le schéma qui se dessine à présent était bel et bien l’objectif visé dès le début.
Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’à l’issue de cette séquence, si elle est effectivement appliquée telle qu’envisagée aujourd’hui, les États-Unis, et plus globalement le bloc occidental, seront en bien meilleure position stratégique, en 2032 ou 2035, qu’ils ne le sont aujourd’hui sur ces deux théâtres décisifs. Et ce, tout en conservant une posture faiblement antagoniste vis-à-vis de Moscou, puisque, dans les faits, les États-Unis se retireront progressivement d’Europe.
7 ans pour mettre les armées européennes sur un pied d’égalité capacitaire avec la Russie
Reste que, pour que l’Europe parvienne à faire jeu égal avec l’outil militaire et industriel de défense russe actuel, dans les années à venir — ce qui est la justification avancée par Mark Rutte pour expliquer ces seuils —, il est nécessaire de s’appuyer sur plusieurs postulats.

Le premier est que la Russie a atteint le plafond de ses dépenses de défense, exprimées en fonction de son PIB, aujourd’hui, et qu’elle ne sera pas en capacité, dans les années à venir, d’augmenter encore les 7,5 % du PIB consacrés aux armées actuellement. En effet, si, demain, Moscou portait son effort de défense à 9 ou 10 % de son PIB, sans altérer sa trajectoire de croissance, il serait certainement nécessaire de revoir les seuils de l’OTAN.
Cela dit, le postulat apparaît solide, si l’on en juge par l’évolution des données macroéconomiques et budgétaires russes ces trois dernières années. Ainsi, pour soutenir son effort de guerre en Ukraine, le Kremlin a été contraint de consommer une majeure partie de ses réserves budgétaires, que ce soit en devises ou en valeurs mobilières.
Dès lors, l’hypothèse la plus probable, en cas de fin de conflit en Ukraine, est que l’effort de défense russe se contractera de 1 ou 2 points, pour revenir à une situation d’équilibre, sans altérer la production industrielle ni le format des armées, en s’appuyant notamment sur la fin des primes d’engagement et les soldes très élevées proposées aux combattants volontaires aujourd’hui.
Dans le même temps, tant que le conflit en Ukraine persiste, l’attrition et les dépenses supplémentaires qu’il engendre permettront à la trajectoire budgétaire européenne de rattraper effectivement l’avance prise par la Russie, de sorte qu’en 2032, le potentiel militaire des deux camps sera probablement équivalent, quelle que soit l’hypothèse retenue concernant la poursuite du conflit en Ukraine, pour peu que la reconstruction économique russe ne soit pas fulgurante.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une fin de conflit « anticipée » en Ukraine, c’est-à-dire en 2025 ou 2026, on peut anticiper que les trajectoires de reconstruction militaro-industrielle russe et européennes viendront créer un décalage qui pourrait s’avérer critique d’ici trois à quatre ans, avec un avantage marqué pour les armées russes.

De fait, le second postulat, pour rendre cette ambition efficace, est que l’Europe demeurera encore pendant plusieurs années sous la protection conventionnelle des armées américaines, précisément pour absorber cet effet de carène, lié à l’imprévisibilité de l’attrition causée par le conflit en Ukraine, et au caractère non évolutif, car déjà très contraignant, des trajectoires européennes.
La France, mais aussi l’Italie, la Belgique et l’Espagne, face à un enjeu budgétaire colossal à franchir
Reste que, si cette trajectoire, à l’échelle européenne et même mondiale, apparaît cohérente, au profit de la sécurité du Vieux Continent et du rapport de forces dans le Pacifique, sa mise en œuvre promet d’être un casse-tête pour plusieurs pays européens, avec, à la clé, de possibles troubles politiques importants.
C’est notamment le cas de la Belgique qui, avec un effort de défense de 1,3 % du PIB aujourd’hui, un déficit public de plus de 5 %, et une dette souveraine de 105 %, devrait effectuer une hausse de 3,7 % en sept ans pour atteindre cet objectif — ce qui semble inaccessible en l’état. D’ailleurs, à la sortie de la réunion OTAN du 5 juin, Théo Francken, le ministre de la Défense belge, a annoncé que le pays était prêt à atteindre l’objectif de 5 % du PIB, mais qu’il nécessiterait plus de temps pour cela.
La situation n’est guère différente concernant l’Espagne, qui, elle aussi, dépense à peine 1,3 % de son PIB pour ses armées, avec une dette souveraine de 102 % du PIB, et un déficit public qui est enfin passé sous la barre des 3 % exigés par Bruxelles (2,8 % du PIB en 2025). Pour l’heure, ni Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, ni Margarita Robles, la ministre de la Défense, ne se sont exprimés à la sortie de la réunion du 5 juin.
Pourtant, il ne fait guère de doute que Madrid fait partie des capitales visées par les remarques de Pete Hegseth, le gouvernement espagnol étant de longue date vent debout contre une augmentation dépassant les 2,5 % du PIB pour le pays, créant un évident malaise au sein de l’Alliance. À noter que l’Espagne fait également partie des pays ayant demandé un élargissement des périmètres considérés concernant les seuils de 3,5 % et 1,5 % du PIB.

Il en va de même de l’Italie, avec un effort de défense de 1,6 % du PIB, pour un déficit public de 3,3 % en trajectoire descendante, mais un endettement souverain de plus de 135 % du PIB. Comme Pedro Sánchez, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien, ne s’est pas exprimée après les annonces de Mark Rutte, mais elle avait fait savoir, depuis plusieurs semaines déjà, que l’Italie n’était pas prête à suivre une trajectoire pour atteindre 5 % en sept ans.
Contrairement à l’Italie et à l’Espagne, la volonté d’augmenter l’effort de défense, au niveau politique comme dans l’opinion publique, ne fait pas défaut en France. En revanche, avec un déficit public de 5,5 %, une dette souveraine de 113 % du PIB, un effort de défense à 2,06 %, et surtout, un chaos politique indescriptible, trouver les marges de manœuvre politiques et budgétaires pour respecter l’engagement pris le 5 juin sera certainement très difficile pour Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense.
D’ailleurs, à l’instar de leurs homologues italiens et espagnols, ni le ministre français, ni le Premier ministre François Bayrou, ni le président Emmanuel Macron ne se sont exprimés publiquement à ce sujet après la réunion du 5 juin, comme c’est le cas, à présent, depuis bientôt trois mois.
Nul doute qu’à présent, pour ces quatre pays, et certains autres, comme le Portugal et la Turquie, l’équation budgétaire induite par cet engagement visé par l’OTAN représentera un sujet de confrontation politique et publique, au niveau intérieur, avec le risque que l’instabilité qui pourrait en résulter s’avère, au final, plus que contre-productive pour la posture défensive globale de l’OTAN.
De fait, pour Mark Rutte, mais aussi pour Pete Hegseth, et même pour Donald Trump, l’objectif, à présent, ne devrait plus être d’obtenir l’accord à tout prix de l’ensemble des membres de l’Alliance, mais de trouver la manière dont les pays en position difficile — comme la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique — pourront résoudre l’équation budgétaire, politique et sociale que cet engagement implique, sans entraîner d’effets de bord bien plus dommageables à l’objectif recherché.
Conclusion
On le voit, tout indique à présent que l’OTAN est bel et bien engagée sur une trajectoire pour faire du sommet de La Haye l’événement refondateur de l’Alliance que beaucoup attendaient. Non seulement les membres sont-ils parvenus, le 5 juin, à s’entendre sur un agenda capacitaire, mais surtout, l’Alliance, dans son ensemble, retrouve une menace identifiée et structurante : la Russie. Elle sait donc précisément quelles mesures prendre pour la contenir.

Au-delà de cet accord capacitaire, Mark Rutte est à présent confiant quant à l’obtention, lors du sommet à venir, d’un consensus visant à amener les membres à consacrer 5 % de leur PIB à la défense nationale et collective, ainsi qu’à la résilience de la nation, selon un calendrier qu’il promet bien plus suivi que ne l’avait été l’objectif des 2 % du PIB, entré en vigueur après le sommet de Glasgow, en 2014.
On comprend également que ce seuil de 5 % correspond à une logique capacitaire effective, même si sa genèse a été chaotique. Non seulement, une fois atteint, il conférera aux Européens les moyens militaires pour contenir, seuls, la menace militaire conventionnelle, et une partie de la menace nucléaire russe, sans les États-Unis ; mais, ce faisant, ce bloc capacitaire fixera l’immense majorité des moyens russes en Europe, interdisant à Moscou toute intervention dans le Pacifique, même en soutien de son allié de fait chinois, face aux États-Unis.
Pour autant, cet objectif ne sera pas simple à atteindre, en particulier pour les pays d’Europe de l’Ouest souffrant de paramètres budgétaires très défavorables, comme la Belgique, l’Espagne, l’Italie, et surtout la France, la seconde économie et la première puissance industrielle militaire du continent.
Toute la question, à présent, sera de savoir comment Mark Rutte, Donald Trump, mais également Ursula von der Leyen, sauront assimiler les contraintes nationales, politiques comme économiques, de ces pays, pour rendre la trajectoire et l’ambition soutenables, sans engendrer une instabilité qui pourrait bien davantage affaiblir la posture dissuasive européenne qu’elle ne l’est aujourd’hui — bien loin de l’objectif visé par l’OTAN dans ce dossier.










![[En Bref] : Spiderweb réveille l’US Air Force, le Canada et le Groenland face à l’hégémonie US, les succès du Gripen et de l’industrie défense israélienne.](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/07/Gripen-E-suede-saab-768x512.jpeg)


![[En Bref] : Spiderweb réveille l'US Air Force, le Canada et le Groenland face à l'hégémonie US, les succès du Gripen et de l'industrie défense israélienne. 20 Mark Carney Emmanuel Macron](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/03/Mark-caney-emmanuel-macron-1280x840.webp)

























![[En Bref] : 12 SSN-AUKUS, 80% de drones et des F-35A armés de bombes nucléaires américaines pour la nouvelle Revue Stratégique de Défense britannique, et les États-Unis qui menace le programme GCAP avec le F-47 au Japon…](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2024/11/SSN-AUKUS_submarine-768x432.jpg)


![[En Bref] : 12 SSN-AUKUS, 80% de drones et des F-35A armés de bombes nucléaires américaines pour la nouvelle Revue Stratégique de Défense britannique, et les États-Unis qui menace le programme GCAP avec le F-47 au Japon... 60 Trump F-47](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/05/presentation-f-47-trump.webp)

![[En Bref] : 12 SSN-AUKUS, 80% de drones et des F-35A armés de bombes nucléaires américaines pour la nouvelle Revue Stratégique de Défense britannique, et les États-Unis qui menace le programme GCAP avec le F-47 au Japon... 63 Drone FPV](https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2025/06/Drone-FPV.webp)